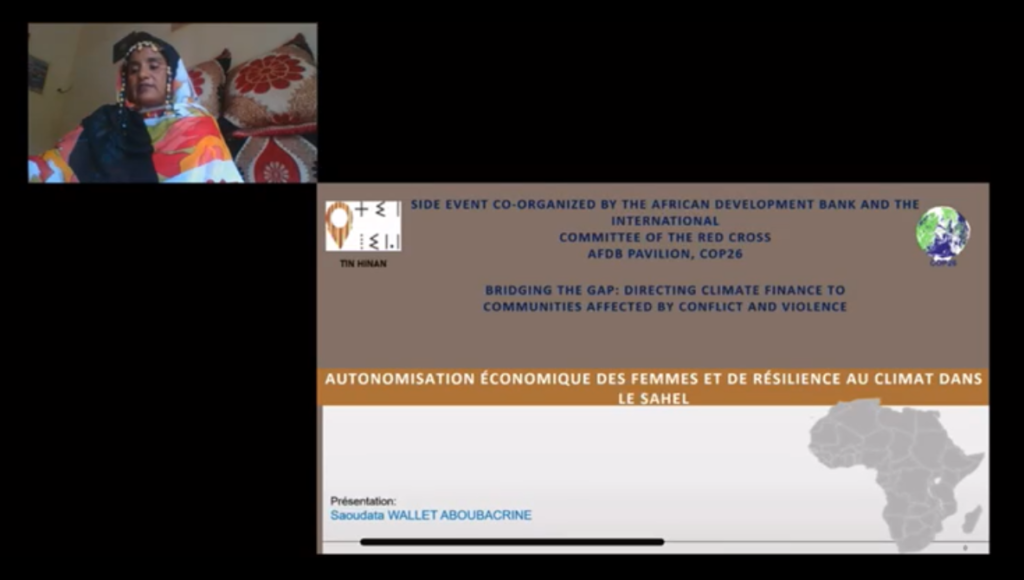Les CIF sont l'un des mécanismes multilatéraux de financement climatique les plus importants pour les pays en développement et travaille en partenariat avec les gouvernements, le secteur privé, la société civile, les communautés locales et six grandes banques multilatérales de développement (BMD). Au sein des Comités décisionnels des CIF, sont représentés les pays donateurs, les pays bénéficiaires et des observateurs représentant le secteur privé, la société civile, les populations autochtones et les communautés locales. Parmi les observateurs représentants les communautés locales et autochtones se trouve Aicha DIALLO, membre de Tin Hinan.
Les observateurs du CIF ont pour rôle principal de veiller à ce que les constituantes qu’ils représentent ne soient pas laissés pour compte dans le design et l’implémentation des projets du CIF. Ils sont donc amenés à apporter des commentaires aux contenus des programmes mis en place par le CIF, ainsi qu’aux différentes décisions prises par les comités, mais surtout de plaider en faveur des constituantes pour qu’elles soient mieux en prises en compte dans les programmes visant la résilience au changement climatique.
En rapport avec les observateurs, il existe dans le cadre du financement climatique, un réseau d’observateurs appelé Stakeholder Advisory Network (SAN), dont font partie plusieurs observateurs du CIF, ainsi que des observateurs d’autres fonds climatiques comme le Green Climate Fund (GCF), Global Environment Facility (GEF), Adaptation Fund (AF). Ce réseau mis en place par plusieurs organisations dont Tin Hinan, a pour objectif principal de promouvoir la bonne gouvernance dans le domaine du financement climatique.
Du 18 au 19 Juin s’est déroulé à Washington, en présentiel, un atelier de renforcement de capacités des observateurs du CIF pour mieux assurer leur rôle de représentations de constituantes, et Tin Hinan a été représenté. Ce fut une occasion de rencontrer les autres observateurs ainsi que le staff du CIF dont Mafalda DUARTE, CEO du CIF, d’en apprendre plus sur les mécanismes des fonds climatiques mais aussi de soulever certaines difficultés rencontrées par les observateurs dans l’exécution de leur mandat. Ils ont été briefés sur les programmes en cours et ceux à venir du CIF, et ont pu plaider en faveur de leurs constituantes pour une meilleure prise en compte, notamment de la question du genre dans les programmes à venir comme le Nature People and Climate (NPC), Renewable Energy Integration (REI), CIF Industry Decarbonization, Accelerating Coal Transition (ACT). Est aussi à prévoir une extension du Mécanisme de Subvention Dédiées aux Communautés Locales et Autochtones (DGM) dont bénéfice le Burkina Faso à travers le Fonds d’Investissement pour les Forêts (FIP) qui est un sous-programme du CIF. Le SAN a été représenté lors de l’atelier pour un partage des connaissances et une coordination entre les observateurs, afin que d’améliorer leur participation significative à tous les niveaux de la prise de décision en matière de financement climatique.
A la suite de cet atelier, se sont tenues les réunions des Comités du Fond Fiduciaire du CIF, du 21 au 23 Juin. Ces réunions, auxquelles ont participé les observateurs, ont été l’occasion de présenter :
- Les résultats des programmes en cours ainsi que les impacts mesurés ;
- Le business plan et le budget du CIF pour l’année fiscale 2023 ;
- Le plan d’intégration du genre dans les programmes du CIF ;
- Les méthodes d’évaluations et d’apprentissage, et la capitalisation du retour d’expérience de l’implémentation des projets ;
- Etc.
A la suite des différentes présentations se trouvaient des décisions qui ont été amendés/approuvés par les comités. Les observateurs ont pu intervenir sur différents aspects notamment, ceux de l’allocation du budget, du monitoring des projets qui n’était pas inclusif, mais aussi de l’intégration du genre sur laquelle Aicha a intervenu et apporté des commentaires sur le fait que le CIF devrait mettre en place des programmes entièrement dédiés aux femmes plutôt que de seulement intégrer la notion du genre dans les programmes. Aussi, elle insisté sur le fait que les parties prenantes locales et les bénéficiaires devraient participer d’une manière effective au design de ces programmes. Compte tenu des disparités culturelles à travers le monde, ce serait le meilleur moyen de connaître et satisfaire les réels besoins de ces femmes. En guise de réponse, le CIF a exprimé la volonté de mettre en place des initiatives de ce genre mais se heurte aux Banques Multilatérales de Développement, en charge du financement et de l’implémentation des projets, et pour qui ce genre de projets ne suscite pas autant d’engouement en comparaison aux autres programmes. Néanmoins, les observateurs aidés du point focal sur genre ont prévu de faire un suivi de la question et poursuivre le plaidoyer.